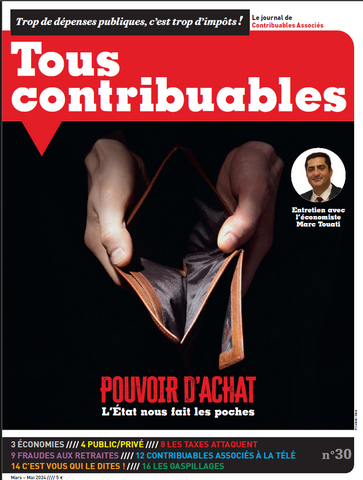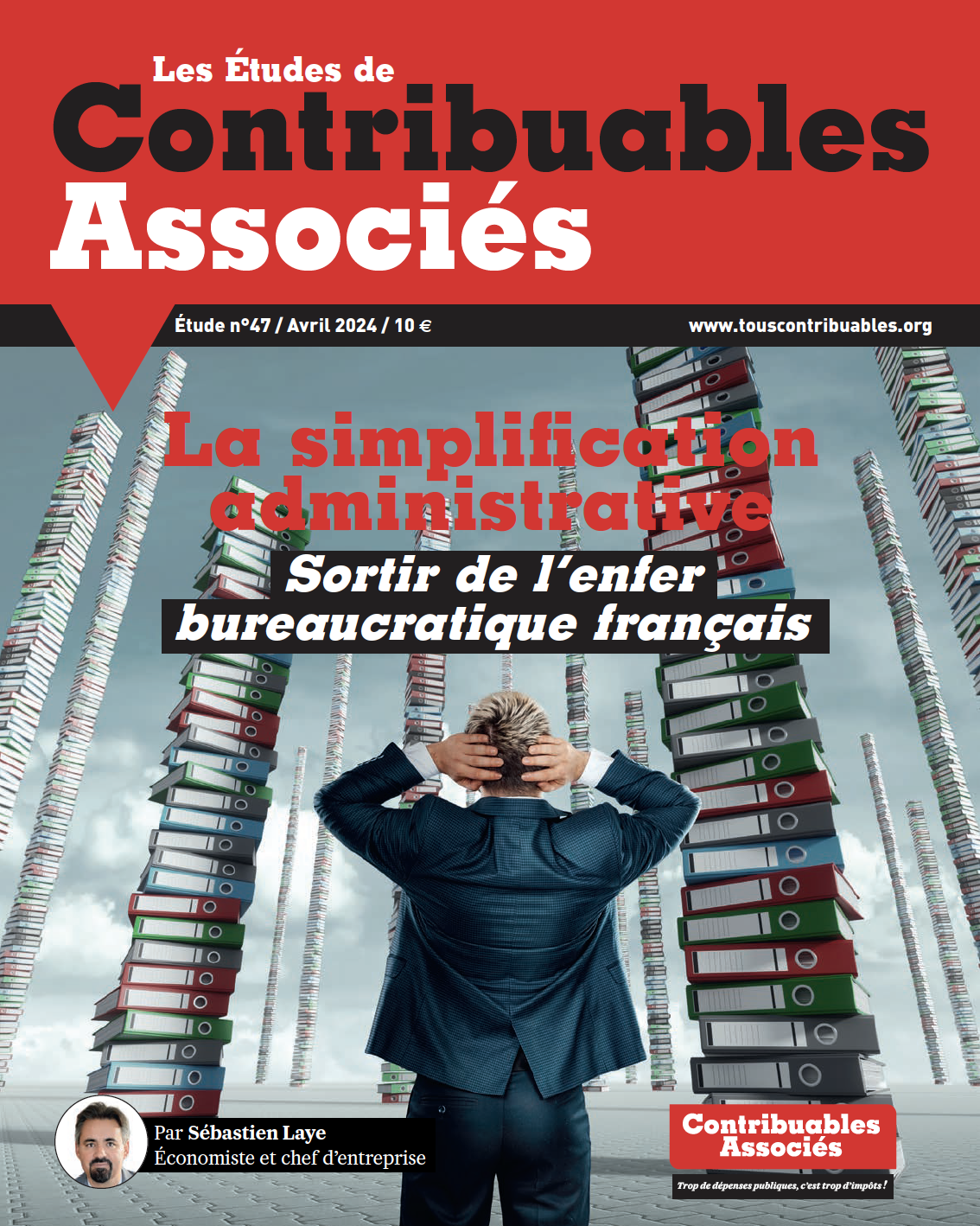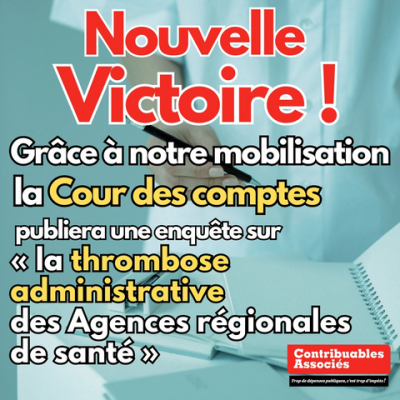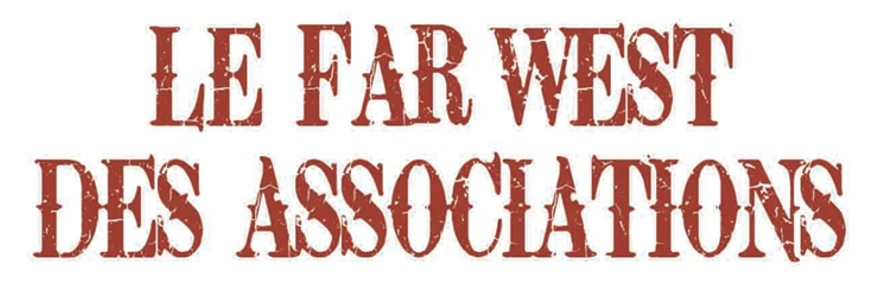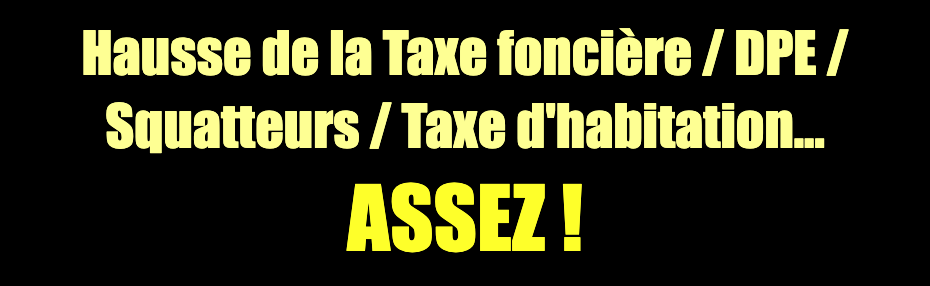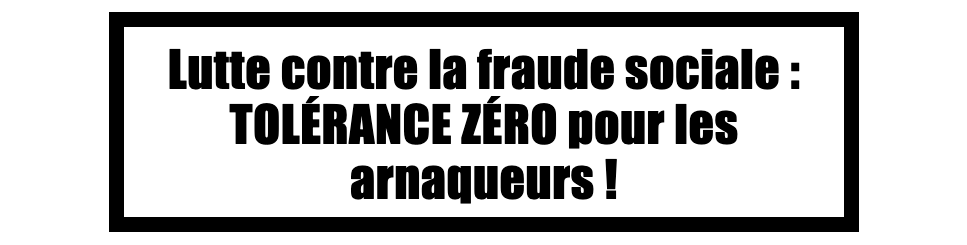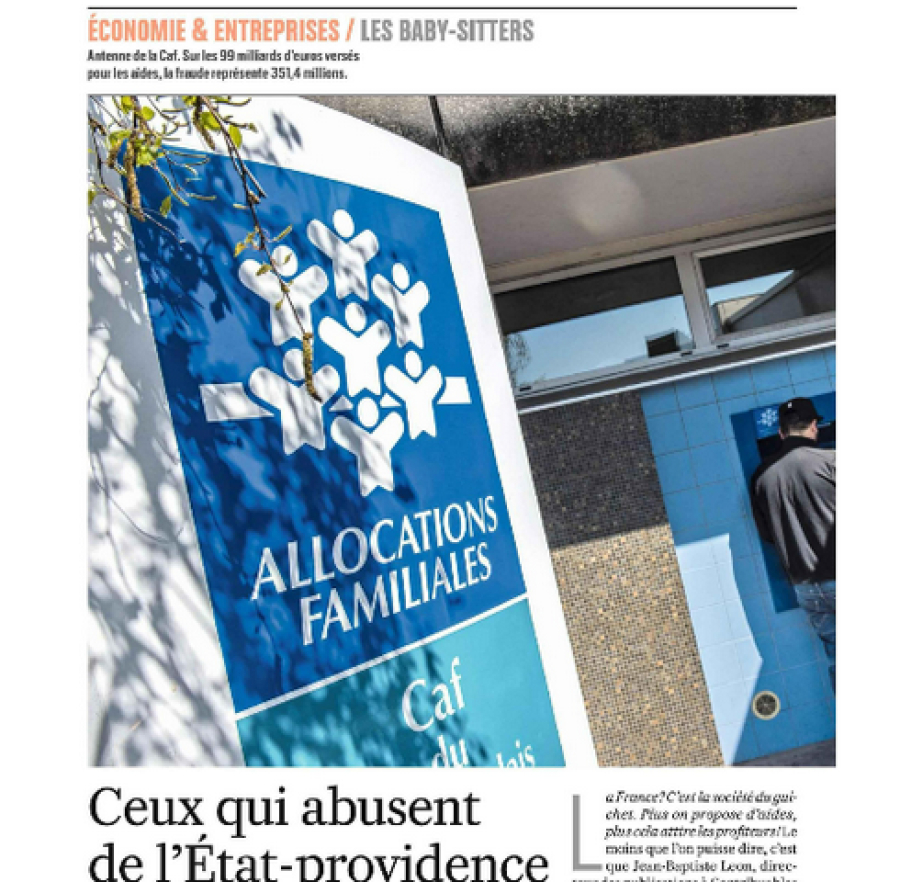À la une
Fin de quinquennat festive pour Emmanuel Macron : l'Élysée s’apprête à passer une commande de 550 000 euros HT pour remplir les caves du Palais présidentiel. Selon les révélations du média « L’Informé », l’Élysée…
La fiscalité des meublés de tourisme style Airbnb n’en finit pas de créer des remous. Plus favorable que celle des locations d’immeubles nus, le gouvernement a voulu remédier à cette injustice lors des débats de…
Sébastien Laye, auteur de la nouvelle étude de Contribuables Associés sur la simplification administrative, était l'invité de Radio Totem, lundi 15 avril 2024. Radio Totem est la radio généraliste incontournable du Sud du Massif Central.…
Lancée à grand renfort de blabla écolo en 2015, la collecte pneumatique des ordures ménagères est finalement abandonnée. Elle laisse une facture de 20 millions d’euros aux contribuables du 17e arrondissement. Tout ça pour ça…
Au-delà des effets de manche, la charge fiscale pesant sur les épaules des contribuables augmente chaque année via les prélèvements directs ou les cotisations sociales. Si Matignon ne parle plus de l’allègement de 2 milliards…
Les déficits et la dette préoccupent les Français. Avant de trouver des remèdes, il convient de cerner au mieux les causes de ces déficits chroniques. L’ancien directeur général des Impôts Jean-Pascal Beaufret publie une note…
Nos dernières pétitions
Trois mille milliards :
les secrets d’un État en faillite
Les Français ont le droit de comprendre qu’une dette pharaonique dans le pays qui a le plus fort taux de prélèvements obligatoires de l’Union européenne révèle une incohérence majeure. Sur un rythme enlevé et dans une démarche didactique, mêlant analyses, témoignages d’experts et graphiques, le documentaire 3 000 milliards : les secrets d’un État en faillite a pour objectif d’expliquer aux Français l’engrenage de la dette et comment nous en sommes arrivés là. Aujourd’hui, la catastrophe est à nos portes si nous ne faisons rien.
Avec
par ordre d’apparition
Jean-Marc Daniel - Économiste et essayiste - Professeur à l'ESCP Christian Saint-Etienne - Économiste et essayiste - Professeur au CNAM Marc Touati - Économiste et essayiste - Directeur ACEDFI François Ecalle - Ancien rapporteur général de la Cour des comptes - Président de FIPECO Édouard Balladur – Ancien Premier ministre (1993-1995) Benoît Perrin – Directeur de Contribuables Associés Virginie Pradel - Avocate fiscaliste - Présidente de l'Institut Vauban Olivier Babeau - Économiste et essayiste - Président de l'Institut Sapiens Jean-Michel Fourgous - Maire d'Élancourt, ancien député François Facchini – Professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Sorbonne François Lainée – Consultant, Data Expert Jean-Baptiste Leon – Directeur des publications de Contribuables Associés Benoîte Taffin - Ancien maire du 2e arrondissement de Paris Paul-Antoine Martin – Ingénieur et essayiste Hervé Novelli - Ancien ministre, député et maire Charles Prats - Ancien magistrat de la Délégation Nationale à la lutte contre la Fraude (DNLF) Pr. Michaël Peyromaure - Chef du service d'Urologie à l'hôpital Cochin et essayiste Lisa Kamen-Hirsig - Enseignante et essayiste
Soutenez notre action pour une gestion économe de l’argent public !
Newsletter
Stop aux gaspillages
Alors que les Parisiens essuient une hausse de la taxe foncière de plus de 60%, Anne Hidalgo, la maire PS de Paris part en escapade en Polynésie sans motif réel et aux frais du contribuable.…
Dordogne. C’est un des plus beaux gaspillages d’argent public de l’année : fin octobre, des bulldozers ont commencé à arracher le bitume d’une route dont la construction a coûté 400 000 euros, il y a…
La Cour des comptes relève de nombreux doublons dans le versement de « l’indemnité inflation » réservée aux personnes « modestes ». Imaginez qu’un magasin vous verse 2 fois, par erreur, une prime de fidélité…
Le Mans : près de 40 000 euros d'argent public sont gaspillés pour l’achat de places restant vides lors des compétions impliquant l’équipe de basket locale, dénonce la Chambre régionale des comptes. Si la tyrolienne…
Nos élus sous surveillance
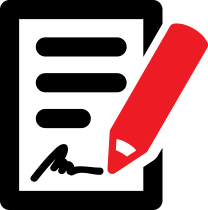
Propositions de loi initiées par Contribuables Associés
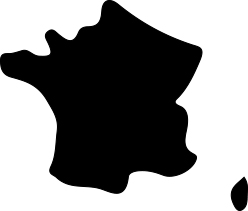
Votre commune est-elle bien gérée ?

Questions écrites de Contribuables Associés

Contribuables Associés
à l'Assemblée nationale
Notre association
L'association de contribuables qui milite pour la réduction des dépenses publiques et contre le gaspillage des impôts !
Contribuables Associés est une association qui agit pour VOUS ! Nous défendons les intérêts des contribuables... Vos intérêts !
Notre leitmotiv c'est:
Ensemble nous pouvons diminuer les dépenses publiques !